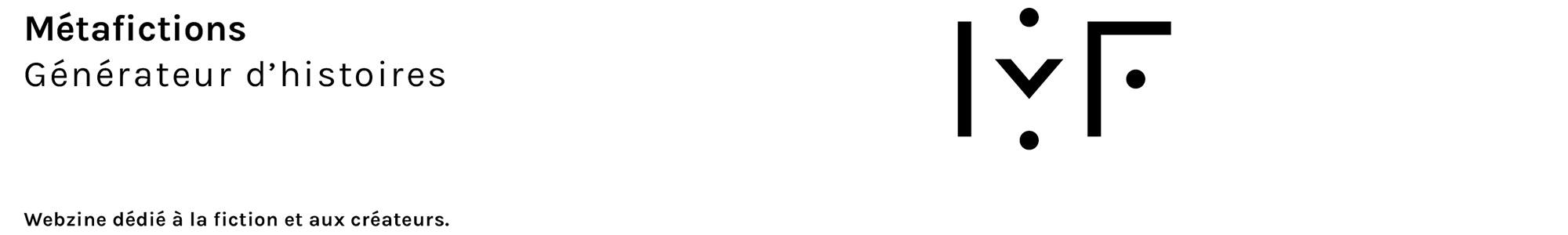Quand on parle de cinéma, dans son sens le plus large et le plus populaire, on pense d’abord à une histoire. On pourrait partir du principe que la définition d’ « histoires » est connue de tous puisqu’on nous en raconte dès l’enfance : elle sont d’ailleurs la clé de l’imaginaire, des songes et des cauchemars. Aussi, comme le rappelle Yves Lavandier dans La dramaturgie, « On ne peut pas vivre sans histoires » : l’histoire serait donc aussi indispensable à notre organisme que l’oxygène à nos poumons.1
Mais il arrive parfois qu’il y ait des films, ou des moments dans certains films, où l’histoire telle qu’on la connaît prend un tour différent et le film cesse d’être une « fenêtre ouverte sur le monde » : le montage brise ses codes et nous exclut de l’intrigue, les personnages s’adressent à la caméra, les anachronismes naissent discrètement, la mise en scène, les sons, les ellipses, plus rien de ce qui fait l’appareil narratif ne semble vraisemblable.
Quels sont les enjeux de tels procédés ? Pourquoi briser le quatrième mur dans une narration qui savait très bien fonctionner ? A défaut de pouvoir répondre de manière exhaustive, faisons l’inventaire des différents procédés, de ce qu’ils engendrent et par quels moyens ils sont invoqués.
Revenons donc brièvement sur une tentative d’explication de ce qui fait narration : Il était une fois l’histoire des histoires…
À l’origine des histoires

Une histoire est une suite de faits exposés de manière orale ou écrite, de manière succincte ou développée par un narrateur. Ce narrateur, ce peut être mon voisin qui me parle de son potager et du nombre d’œufs que ses poules ont pondues depuis le début de la semaine, le reporter à la télévision, l’ami qui a fait une très belle rencontre au café, mais c’est aussi l’auteur, le réalisateur, le peintre, le metteur en scène/en images/en sons.
Avoir quelque chose à dire, c’est être narrateur de ce quelque chose là. Et être narrateur, c’est choisir. Choisir ce que l’on raconte et comment on procède. Et donc, par conséquent, s’il y a narration (ou récit), il y a discours.
À la recherche du sens
Le discours, dans son sens le plus large, c’est un peu ce qui se cache sous l’histoire. Admettons que j’ai l’idée d’une histoire, que je l’invente. Pour raconter mon histoire, il faut que je choisisse un médium, celui qui me paraît le plus adapté à ce que je souhaite raconter : ça peut être un livre, une pièce, un film etc… Dès que j’ai fait le choix du support (ou du médium), j’ai choisi le discours et le récit commence. Journot dans son Vocabulaire du cinéma explique : L’ « histoire » est une succession des événements à narrer encore indépendante du média [du « discours »] qui va l’organiser en récit.
Autrement dit, l’histoire en tant que telle, à l’état d’idée, n’existe pas. Ou du moins elle existe dans le domaine des idées. Pour qu’elle existe dans le domaine de l’histoire, elle doit être matérialisée par un récit, c’est sa mise en forme qui lui crée des liens et une structure.
Le film traditionnel, populaire, grand public, dit « hollywoodien », « blockbuster » ou bien de « fiction » est un film qui se donne comme histoire, non comme discours, semblable à cette « fenêtre ouverte sur le monde » dont parlait André Bazin. Et c’est justement cela qui fait sa force, son efficacité : en apparence, en effet, l’histoire est donnée en tant que telle et rien ne semble lui présider. Mais dans les faits, elle est bel et bien à la fois histoire et discours. Elle est une histoire qui a gommé les traces de son support discursif pour emmener le regardeur/spectateur/lecteur dans les voies de sa narration, lui faire oublier ce qu’elle est : une idée structurée. En bref, on peut dire que ce qui fait discours dans une histoire c’est ce qui marque la présence plus ou moins cachée de l’auteur. De manière générale, c’est le message.
Le caché et le révélé
La littérature, le cinéma ou tout autre art qui fait récit, énonciation et histoire ne sont pas purement décoratifs. Aussi, l’intelligence d’une histoire ne réside pas seulement dans la façon dont les événements s’agencent, elle est aussi dans la manière dont les mots, les figures, les points de vues se combinent.
Pour reprendre l’expression du chercheur Jean Marc Limoges, il y a des films qui « se déguisent » en histoire : pour qu’on croit à leur réalité, à leur vraisemblance, ils devront effacer les traces de leur énonciation (prises de vue, prises de son, technique) et de leur narration (montage, bruitage, étalonnage, mixage…). En somme, ils devront jouer la carte de la transparence.
On distingue aussi ces films qui « se désignent » comme discours : le discours cesse d’être le « véhicule transparent » de l’histoire, il utilise le procédé narratif par excellence – le montage – pour mieux se révéler. En effet, si l’on considère que le raccord est le moyen de rendre plus transparente cette « fenêtre ouverte sur le monde » qu’est le cinéma, alors le faux raccord est le meilleur moyen de l’opacifier, d’empêcher de voir quelque chose et peut être alors, de mieux révéler autre chose.2
L’exemple le plus célèbre d’histoire qui se désigne en tant que discours est probablement À bout de souffle de Jean Luc Godard, où l’on retrouve plus que très fréquemment des faux raccords, des jump cuts à l’image ou des ruptures dans le son. Dans ce film, les faux raccords sont à l’image du personnage Michel Poicard (Jean Paul Belmondo): ils sont nonchalants, surprenants et finissent par devenir très prévisibles. Les jump cuts, quant à eux, sont plutôt le pendant féminin, le personnage de Patricia Franchini (Jean Seberg), ils dynamisent et vampirisent le récit, ils annoncent déjà la chute du personnage au cœur même du récit. On osera une analyse du procédé de post-synchronisation sonore utilisé dans le film. En effet, les corps et les lèvres bougent, c’est un son doublé qui en sort et pourtant, même si l’illusion semble avoir opéré, un autre sens s’offre à nous. On nous parle de quelque chose, on nous montre autre chose et de cela naît un troisième sens. Alors, que révèle ce montage sonore sur le récit de Godard ? Peut-être qu’il ne faut pas toujours faire confiance, car les corps disent ce que les mots taisent. La fin du film le montrera d’ailleurs : Michel, trahi par Patricia, s’effondre dans la rue, abattu par la police.

Selon Ihab Assan, l’un des attraits de la fiction post-moderne réside dans sa capacité à questionner ses modes de représentation conventionnels. Il s’agit, selon lui, de déconstruire, de déplacer et de démystifier un ordre des choses, un système de valeurs. Ainsi, en se jouant des concepts narratifs traditionnels de temps, de lieux et de vraisemblance du récit, un auteur peut créer un espace où il est possible de représenter avec justesse une nouvelle manière de faire récit : en révélant l’énonciation et en l’enrichissant. Certains chercheurs, comme Susan Hayward3 qui s’est intéressée à l’émergence d’auteurs post-modernes, assimilent le mouvement à une tendance au régressif, à la dépolitisation. Un mouvement en somme stérile. Pourtant, il ne se limite pas à un nivellement des sens et des valeurs ; ce n’est pas parce qu’il n’y a pas engagement qu’il y a nécessairement désengagement, que la poésie est absente ou que l’émotion a disparue. La valeur du mouvement post-moderne réside en ce qu’il questionne le langage (ses limites, ses fins, son origine) ainsi que des notions tels que rationnel/irrationnel, sujet/objet, masculin/féminin. Il questionne la possibilité d’un autre système de représentation.4
Vérités et invraisemblances
Enfin, il existe aussi les films qui « se désignent » comme histoire.5 C’est à dire qu’en tant qu’histoire avant tout, ils s’affranchissent partiellement ou totalement de la réalité. Après tout, ne parle-t-on pas de « film de fiction » ? Ces récits absurdes, ces méta-récits de l’invraisemblance sortent un peu des sentiers battus pour proposer des narrations plus atypiques. On trouve donc, à l’origine de ce mouvement au cinéma, le réalisateur Luis Buñuel qui a été un des premiers, à la suite des surréalistes en littérature ou au théâtre, à briser l’illusionnisme de la réalité au cinéma.
« Il y a le classicisme (c’est à dire le respect du vraisemblable) et le modernisme (c’est à dire le mépris des vraisemblances) »6

Ainsi, à la suite de Buñuel, on trouve aussi Bertrand Blier qui, par son travail, notamment dans le film Merci la vie et son jeu sur les filtres monochromes colorés, les ellipses et les flash-back apporte à son tour une pierre à l’édifice de la révélation de la pensée du récit par l’invraisemblance de l’histoire. De nombreux films des années 70 suivent d’ailleurs l’exemple de Luis Buñuel en exploitant une stratégie du grotesque et du carnavalesque : tout est trop ou de trop et chaque envie, chaque désir, chaque obsession, prennent des proportions démesurées. Citons par exemple La grande bouffe de Marco Ferreri où il est question de quatre amis amateurs de calme et de bonne chair, qui s’enferment un week-end entier dans une maison de campagne pour manger les plats les plus luxueux jusqu’à une issue des plus grotesques et pathétiques. Il y a aussi la passion violente du Dernier tango à Paris, de prosaïque à poétique. Plus proche de nous, Les rencontres d’après minuit de Yann Gonzalez, très largement inspiré des travaux de Luis Buñuel et Paul Vecchiali, met en scène plusieurs archétypes (la chienne, la star, l’étalon, l’adolescent) au sein d’une orgie prévue dans un appartement. Les archétypes ne répondent bien entendu pas à ce qu’on attend d’eux, les personnages se rencontrent par la parole plutôt que par le physique et l’issue en est plus tendre que charnelle. La fiction avant tout, la fiction et l’histoire. Pour la réalité, on verra plus tard.
Le film pourra aussi se désigner comme histoire en attirant notre attention sur un aspect nouveau apporté par lui-même sur un canon de genre. Il arrive que le film décide de rompre avec les codes du genre dans lequel il s’inscrit. Attardons-nous sur la série Bored to Death écrite par l’auteur Jonathan Ames et mettant en scène un personnage homonyme. Dans cette série, Ames (Jason Shwartzman) tente d’écrire un roman mais l’inspiration ne lui vient pas. En plus, il a besoin d’argent. Alors il décide de publier une annonce sur internet pour devenir détective privé.

Loin de représenter l’image du détective tel qu’on se l’imagine, Jonathan Ames est plutôt petit, timide, boit du vin blanc et trouve toujours à se mettre dans les problèmes les plus insolvables lors de ses enquêtes. Un autre exemple, celui d’une Anna Karina chantante, entre salon et salle de bain dans Pierrot le fou, alors qu’un cadavre fraîchement tué est étendu sur le lit. Ces ruptures paradoxales (puisque non conforme à l’opinion commune que l’on pourrait s’en faire) mettent en place les moyens de « faire décrocher » de l’histoire, de rappeler au spectateur son statut, mettre à mal ses croyances en la fiction pour lentement insinuer qu’il est devant un film et qu’un film, on le sait, ce n’est pas la réalité.
À ce chapitre aussi, on peut citer les invraisemblances historiques, de l’ordre de l’utopie ou de l’uchronie, les histoires qui réécrivent l’Histoire, ce qu’elle aurait pu être. C’est le cas du western Blackthorn qui prétend que Butch Cassidy n’est pas mort mais qu’il se cache, d’Inglorious Basterds qui propose une vengeance des juifs contre les nazis et fait mourir Hitler par balle dans un cinéma plutôt que dans un bunker. Sans oublier les nombreux détails anachroniques qui peuplent les aventures en bande dessinée d’Astérix et Obélix. Ce sont aussi la paire de converses dans le Marie Antoinette de Sofia Coppola. De telles invraisemblances historiques sont assumées et posent une véritable question sur les personnages, le récit et l’histoire. Le spectateur n’est plus considéré comme un consommateur passif face à un objet, il doit être en réflexion sur lui-même, comme l’est le film. Pour le lecteur ou le spectateur renseigné, compétent ou éclairé, tout concourt à le faire décrocher de l’histoire. Et pourtant, c’est parce que cette histoire est invraisemblable qu’elle révèle son véritable sens. On pourrait imaginer qu’un film qui se désigne en tant qu’histoire (et qui par conséquent met son parti pris d’invention au cœur du récit) est un film dont le message est le plus prégnant.
Par tous les moyens cités plus haut, le film se fait réflexif : en brisant les codes de son montage, de sa mise en scène, de ses personnages, de ses intrigues ou de ses contextes, il interroge le sens en abolissant la transparence du récit et en fuyant la vraisemblance. Car ce n’est pas parce que l’on fuit la réalité en jalonnant le récit d’erreurs volontaires, d’invraisemblances provocantes et de fautes de goût que c’est forcément raté. Interrogé sur l’invraisemblance au cinéma dans l’émission radiophonique Remède à la mélancolie, Jean Michel Ribes disait : « Je n’ai pas besoin de voir la réalité au cinéma, si je veux voir la réalité, il me suffit de sortir dans la rue et de rencontrer des gens. »
Si fuir la vraisemblance n’est pas la seule façon de faire ou d’aimer le cinéma, c’est en tout cas l’une des plus poétiques, car elle se permet d’être contrastée. Et c’est bien le contraste qui révèle les nuances.
1 La Dramaturgie, Yves Lavandier, Cergy, Le Clown et l’enfant, 2011
2 Voir les travaux de recherches de Jean Marc Limoges au sujet de l’auto-réflexivité cinématographique.
3 Susan Hayward, French National Cinema, London : Routledge, 1993, p.305
4 Voir Martine Beugnet, Marginalité, Sexualité et contrôle dans le cinéma français contemporain, L’Harmattan, 2000
5 Voir Jean Marc Limoges
6 Gérard Genette, Vraisemblance et motivation, p77-78