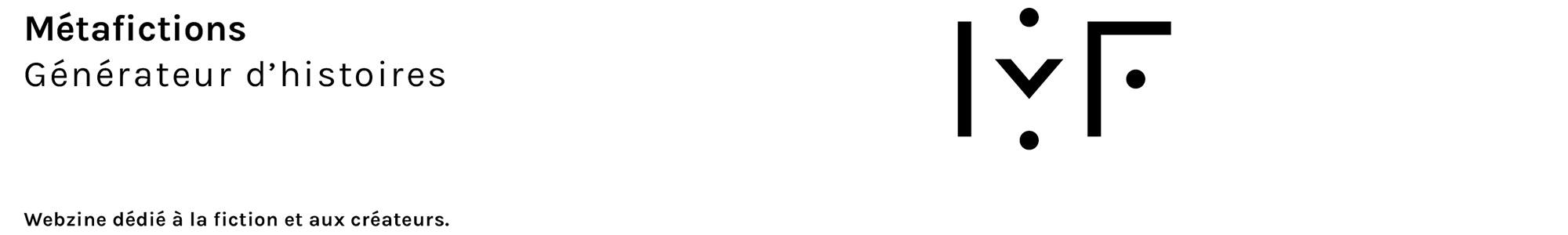Pearl Harbor1 est un lointain souvenir pour les fans de Michael Bay, qui lui préfèrent souvent ses films suivants. C’est surtout le projet qui a achevé de faire mauvaise réputation au réalisateur auprès de la critique et des professionnels. Rétrospectivement, le film marque cependant un tournant clair dans la filmographie de Bay ; c’est pourquoi nous vous proposons un retour sur cet épisode de son parcours.
Contexte
Il a beaucoup été dit à la sortie de Pearl Harbor, et souvent de manière négative. Ajoutons à cela les nominations aux Razzie Awards et les railleries sur le cas Ben Affleck. Ici, il s’agira plutôt de revenir sur un film qui semble avoir scellé le destin de son réalisateur.
Lorsque le film sort en 2001, Michael Bay est avant tout le nouveau golden boy de l’écurie Bruckheimer, qui va lui confier ce qu’il déclarera être « le film le plus ambitieux qu’il n’ait jamais tenté de faire ». Selon lui encore, « seul Michael Bay pouvait réaliser Pearl Harbor. » (voir vidéo en fin d’article) Il faut dire que tous les films précédents du duo ont été des succès : Armageddon2, le dernier en date, a dominé le box-office en 1998. À l’époque déjà, paradoxalement, la réception critique des films de Bay est inversement proportionnelle aux succès qu’ils rencontrent en salles. Le grand cinéaste John Boorman (Delivrance3, Le Point de Non Retour4, Excalibur5) n’est pas non plus un fan :
« Quand on regarde un film comme Armageddon, il est incroyable de voir à quel point plus aucune règle n’est appliquée. C’est un cinéma que j’ai surnommé « néo-brutalité », et qui fonctionne en fait sur une sorte de naïveté, parce qu’il est fait par des cinéastes qui, par défaut ou par choix, n’ont pas voulu apprendre les règles de base du langage cinématographique. Leur grammaire visuelle est celle de MTV, où, en gros, tous les coups sont permis si l’on peut arriver à un résultat excitant. Parce que j’ai une assez haute idée du cinéma, et que quand je vois un film tourné comme ça, j’ai l’impression de voir un vieillard qui essaie de s’habiller comme un ado. »
Avant d’arriver au cinéma, Michael Bay a effectivement fait ses gammes dans la publicité en travaillant pour de grandes marques (Coca-Cola, par exemple, qu’il fera revenir le temps d’une séquence dans Pearl Harbor comme un échange de bons procédés – le placement de produits est récurrent dans ses films, nous y reviendrons plus bas), et dans le clip, pour des artistes comme Tina Turner, Aerosmith et Lionel Ritchie.
Il est intéressant de noter que Michael Bay a récolté plusieurs prix prestigieux pour son travail dans ces domaines, ce qui ne sera plus le cas après son passage au cinéma.

Pearl Harbor est d’abord et avant tout une machine commerciale. Tout a été pensé pour que le film soit un succès commercial, et le résultat financier sera effectivement à la hauteur des calculs. Écrit par Randall Wallace, le scénariste de Braveheart6, Pearl Harbor retranscrit l’un des épisodes les plus importants de l’histoire américaine.
Au casting se retrouvent des valeurs montantes hollywoodiennes : Ben Affleck, remarqué dans le cinéma indépendant chez Kevin Smith (Chasing Amy7 et Mallrats8), vedette d’Armageddon, oscarisé pour le scénario de Will Hunting9, et à ses côtés Josh Hartnett, qui sort du succès commercial de The Faculty10 et d’un second rôle remarqué dans Virgin Suicides11.
Malgré tout, et contrairement aux films précédents de Michael Bay, Pearl Harbor aurait pu prétendre à un autre sort que celui de devenir un produit de pur entertainment, que les détracteurs qualifieront plus tard de décérébré, frénétique et insupportable, les autres d’efficace et jouissif. Le réalisateur avait d’ailleurs conscience de ce potentiel, puisqu’il déclarait à la sortie du film :
«C’est le projet le plus ambitieux et le plus captivant sur lequel il m’ait été donné de travailler. »
Pearl Harbor aurait voulu et aurait dû être ce qu’a été Titanic12 pour James Cameron, à savoir l’avènement et la consécration définitive d’un cinéaste ; avoir un impact commercial, certes, mais également un impact sur la mémoire des spectateurs. Pearl Harbor souhaitait faire date, réussir à lier l’intime au spectaculaire, marier la petite histoire et la grande Histoire, impressionner et bouleverser, et Michael Bay s’inscrire dans la lignée des grands cinéastes classiques américains tels David Lean ou Douglas Sirk.
C’est à cet écart entre des ambitions a priori élevées et un résultat très contesté que nous allons nous intéresser. Ce mariage improbable entre un réalisateur, tête de gondole de la « génération MTV », et un cinéma classique en voie de disparition.
Diagnostic
Il faut préciser avant tout qu’il existe des cas dans l’histoire du cinéma où un réalisateur affublé d’une certaine étiquette, globalement peu considéré par les critiques, parvient à surprendre son monde et signer un film qui laisse une trace, en s’aventurant dans un genre ou un style opposés à ses habitudes.
C’est notamment le cas d’Adrian Lyne, réalisateur britannique, rendu célèbre avec Flashdance13 dans les années 80 (un des premiers « hits » produits par Jerry Bruckheimer), puis 9 semaines 1/214 et Liaison fatale15. Associé au registre de « l’histoire d’amour sulfureuse », il surprit en 1990 avec L’Échelle de Jacob16, thriller labyrinthique qui reste à ce jour une heureuse anomalie dans sa filmographie.
Ironie du sort, ce seul succès critique s’accompagna de l’unique échec commercial de sa carrière.

Si Pearl Harbor diffère de cet exemple, c’est parce que Michael Bay, malgré le changement de genre, ne s’écarte pas de ses procédés stylistiques habituels.
Ses effets de style et sa grammaire visuelle ont beau être contestés, le réalisateur s’y tient. On peut voir Michael Bay comme un réalisateur prêt à « mourir pour ses idées », ou, plus simplement, incapable de s’en défaire.
Les couchers de soleil faussement iconiques, la fascination pour la taule froissée et l’artillerie lourde, les ralentis dopés à la musique « lourde » ici signée Hans Zimmer (déjà à l’oeuvre sur The Rock17), le montage épileptique qui vire au chaos visuel… On retrouve bel et bien tout ça dans Pearl Harbor.
Premier problème : l’action n’est pas dominante dans le film. Sur près de trois heures, elle occupe environ un tiers du long-métrage. Il y a donc nécessité de faire exister les personnages principaux, construire leurs rapports pour pouvoir imbriquer leurs histoires et l’Histoire, et accessoirement proposer au spectateur autre chose que des effets visuels et un déluge pyrotechnique. Mais le réalisateur s’avère en être incapable. Dès le début du film, on note déjà des perles de clichés sur les allemands et les français, l’éducation, l’armée, et une vision archi-caricaturale de « l’american way of life ».

Le scénario est une chose, l’approche du réalisateur en est une autre, et laisser ses acteurs en roue libre est un choix (ou un non-choix) extrêmement périlleux. C’était déjà le cas dans ses précédents films, et c’est un reproche qui lui a souvent été adressé par ses acteurs eux-mêmes. Kate Beckinsale, paradoxalement moins perdue que les autres, ne manquera pas de le dire : ce qui intéresse Michael Bay, c’est les explosions, la pyrotechnie. Les acteurs, il s’en fiche. Lorsqu’il collabore avec des comédiens ayant une certaine facilité à se passer de directives ou à imposer leur style, l’illusion peut fonctionner. On pense notamment à Will Smith et Martin Lawrence dans les Bad Boys18, ou Shia LaBeouf dans Transformers19. À l’inverse, quand Bay collabore avec des acteurs moins autonomes ou plus dépendants de leur relation avec leur réalisateur, un problème se pose. C’est ce qui se produit avec Ben Affleck (par ailleurs irréprochable dans ses propres réalisations, chez Gus Van Sant, Kevin Smith, Terrence Malick ou David Fincher), qui livre dans Pearl Harbor une interprétation assez douloureuse pour lui comme pour le spectateur. Josh Hartnett, lui, est un peu plus effacé, mais il n’est pas plus convaincant. Dans ces conditions, difficile de s’attacher à des personnages qui, bien que défendus tant bien que mal par des comédiens en recherche de repères, ne sont soutenus ni par les dialogues, ni par les situations, peu inspirées et parfois grotesques.
Le film raconte une histoire d’amour impossible. C’est une recette qui a fait ses preuves. On est pourtant très loin de la force dramatique de Titanic. Les choix de mises en scène de cette histoire d’amour peuvent par exemple laisser perplexe : lorsque les personnages de Rafe (Ben Affleck) et Evelyn (Kate Beckinsale) se retrouvent séparés parce que le premier s’est porté volontaire pour combattre aux cotés de l’armée anglaise, leur romance continue par correspondance. La force du conflit dramatique est bien là, mais le réalisateur l’illustre en filmant Evelyn, lisant les lettres de Rafe sur un rocher, avec les vagues d’une plage hawaïenne en arrière-plan. Ce qui rend caduque la notion de danger qui guette Rafe et rompt avec le contexte de guerre qui entoure le récit.
Cette romance, conçue pour attirer un public plus féminin, convainc donc difficilement. Le niais prend le dessus sur le romantisme. Il reste alors deux aspects à Michael Bay pour convaincre : l’historique et le spectaculaire.
Le script n’étant pas signé du réalisateur, on passera rapidement sur le traitement de l’Histoire dans le scénario. Les approximations et raccourcis historiques sont nombreux – la page Wikipedia du film prend soin d’énoncer ces diverses « erreurs ». Michael Bay n’a fait que grossir des traits déjà épais sur le papier. Il ne s’agit pas pour lui d’expliquer, ni de clarifier les enjeux de la guerre, mais d’exhiber la bravoure et le courage américains contre la vilenie et la lâcheté japonaise. On ne demande pas à Michael Bay de faire une analyse géopolitique ou historique, mais son peu de mesure pose question, surtout quand il explique avoir interviewé 70 survivants, dont certains étaient présents sur le tournage. Il confesse même avoir été bouleversé par ces témoignages, et parait sincère lorsqu’il tient les propos suivants :
« Ce film provoque beaucoup d’émotions. On apprend quelque chose sur cette journée. On découvre le caractère de ces gens. Ils étaient dévoués à l’Amérique, leur pays passait avant leur vie. C’est incroyable comme notre pays s’est ressaisi. » (voir vidéo en fin d’article)
Pourtant, le manichéisme total du film, sa naïveté et son premier degré génèrent davantage la raillerie que la fascination. Comme cette réplique de Rafe qui, à peine arrivé en Angleterre, veut déjà partir à l’attaque : « Tous les Américains sont aussi pressés de se faire tuer ? », « Je ne suis pas pressé de mourir, mais d’intervenir », répond Rafe.
On se rappelle également cette séquence où le président Roosevelt, peu après l’attaque de Pearl Harbor, alors en fauteuil roulant et privé de l’usage de ses jambes, se lève pour rappeler à son état-major qu’impossible n’est pas américain.
Des séquences de cet ordre-là, le film en regorge. Terminons sur l’exemple du monologue final d’Evelyn :
« Avec le temps, tout ça nous apparaît à la fois plus clair et plus complexe. Mais une chose au moins est certaine, avant l’opération Doolittle, l’Amérique ne connaissait que la défaite. À partir de là, elle a renoué avec la victoire. Le Japon a pris conscience qu’il pouvait perdre et a commencé à reculer. L’Amérique a compris qu’elle pouvait gagner, et elle a avancé. Cette guerre a changé notre pays. Doris Miller fut le premier noir américain décoré de la Navy Cross, et il ne fut pas le dernier, d’autres le furent à leur tour. (…) Pour nous, la Seconde Guerre Mondiale commença à Pearl Harbor, et 1177 hommes reposent toujours dans l’épave de l’Arizona. L’Amérique a souffert, mais l’Amérique s’est fortifiée. Ce n’était pas inévitable, ces épreuves ont trempé nos âmes, et dans l’épreuve, nous nous sommes dépassés… »
Monologue qui donne lieu à une séquence éblouissante, autant par sa naïveté (grossièreté ?) que par le sérieux et le premier degré avec laquelle elle est écrite, jouée et illustrée. Il apparaît que ce prototype de cinéma patriotique et propagandiste est devenu avec le temps totalement désuet, particulièrement lorsqu’il prend une forme aussi directe.
Involontairement et de façon surprenante, Michael Bay met en péril ce courage et cette bravoure qu’il vante. En effet, comme souvent dans ses films, il parsème dans ses scènes un humour puéril et bas du front. Si cet humour peut avoir sa place dans Bad Boys ou Transformers, il est en revanche périlleux dans Pearl Harbor. Bay a-t-il conscience que lorsqu’il filme les beuveries des soldats, ou le bonheur des infirmières à côtoyer les militaires, le résultat est au mieux ridicule, au pire totalement inconséquent ?
Le scénariste ou le producteur ne peuvent pas être accusés à sa place. On se rappelle que sur la même période, Bruckheimer a développé un autre film : La chute du faucon noir20, réalisé par un Ridley Scott venu lui aussi de la publicité, et qui mettait également en scène une mise en déroute de l’armée américaine. Sans en être le scénariste, et dans des conditions de travail similaires (temps de tournage et budget moins importants -une anecdote raconte même que Scott, remplaçant un autre réalisateur, n’a eu deux semaines pour préparer son film alors que le tournage était déjà entamé), Scott développait un propos beaucoup plus ambigu, nuancé et concerné.
Revenons maintenant sur le clou du spectacle, qui était à l’époque l’une des principales raisons de se déplacer en salles : la fameuse scène d’attaque de Pearl Harbor. Après avoir passé du temps à raconter les atermoiements amoureux de ses protagonistes, Michael Bay peut enfin de lâcher, et il en profite : la séquence s’étale sur près de quarante minutes.
On ne l’a pas dit explicitement en évoquant sa direction d’acteurs et l’intérêt qu’il porte à ses personnages, mais Michael Bay n’est clairement pas un « storyteller ». En revanche, on lui concède sans difficulté une totale maîtrise technique et une volonté de précision dans les détails (distances entre les avions, bombardements, mouvements des bateaux…) sur lesquels Bay a fait de véritables recherches et dispose de moyens conséquents (aide du Pentagone, mise à disposition de matériel militaire, scène d’attaque en multi-caméras…). Mais maîtrise technique ne rime pas forcément avec rigueur de mise en scène et on repense aux propos de John Boorman : « Tous les coups sont permis si l’on peut arriver à un résultat excitant. »
La scène de l’attaque illustre bien ce fait : durant ce long moment de bravoure, on observe des plans souvent sidérants visuellement, mais noyés dans une masse où le chaos visuel prend la place du point de vue, ce qui annihile tout le potentiel spectaculaire de la séquence.
En effet, dans cette scène, le seul éventuel choix de Michael Bay consiste à filmer du point de vue d’une bombe. Cela peut faire son effet la première fois, on pourra même trouver ça « osé ». Mais quand la scène tire sur la longueur, et que les différents personnages sont jetés dans l’action, on ne sait plus qui ou quoi suivre. Les explosions et mitraillettes intéressent plus le réalisateur que les héros. Et l’ennui finit par se manifester. Ces négligences impactent ainsi jusqu’à la scène-clé du film. Le montage ne prend jamais le temps de laisser respirer l’action, la caméra ne se repose jamais. L’absence de point de vue finit de brouiller les repères spatiaux et temporels du spectateur.

Pourtant, Michael Bay sait a priori mettre en valeur ce qui a besoin de l’être, comme en atteste son passé de publicitaire et sa renommée dans le milieu. Quand il filme les hôpitaux remplis de victimes suite à l’attaque, et qu’il fait le choix de focaliser l’attention du spectateur non pas sur les victimes mais sur les bouteilles de Coca-Cola dans lesquelles sont versées le sang, comment est-il possible de ressentir une éventuelle émotion pour les blessés ?
Le logo de la célèbre marque devenant plus important que la situation, peu importe que l’anecdote soit vraie : peut-elle légitimement prendre le dessus sur le reste ? Bien sûr que non.
En conclusion, le film paraît comme rongé par l’obsession de Michael Bay qui veut imposer sa griffe, ce qui a plus tendance à enfoncer le film qu’à le sauver. Bay se révèle incapable de contenter les différentes catégories de public visées : les amateurs de romances, d’Histoire, et même d’action.
Les ambitions de départ génèrent les railleries de toutes parts, et Michael Bay entend le message : il ne tentera plus par la suite de réaliser un film aux ambitions aussi ouvertement sérieuses.
Conséquences
Michael Bay ne cherche plus l’approbation de ses pairs. Il choisit de prendre le public et le box-office pour seules références, oubliant la critique. La sincérité entrevue laisse place à un cynisme qui va guider la suite de sa filmographie.
En 2003, il réalise avec Bad Boys II21 ce que nombre de ses fans considèrent comme son « chef-d’oeuvre ».D’autres le qualifieront de « navet insupportable et interminable ». 2h20 d’action décérébrée, d’humour vulgaire où le réalisateur ne se refuse rien : on retiendra la célèbre course-poursuite sur l’autoroute où voitures et bateaux volent à l’écran, puis une autre course-poursuite, dans la même idée, avec des cadavres tout droit sortis de la morgue. Bad Boys II regorge de ces moments de finesse.
Le réalisateur ne réfrène aucun de ses effets de style, bien au contraire : multiplication de ses fameux travellings circulaires qu’il reprendra ensuite successivement dans The Island22 et le premier Transformers, ralentis poseurs et iconiques, les traditionnels couchers de soleil…
Bad Boys II est le film de tous les excès, au point qu’il scindera le public en deux : ceux qui y voit une nullité absolue, et ceux qui trouvent dans ce film une jouissance régressive sans précédent, comme si le réalisateur s’était décidé à jeter à la figure de ses détracteurs tout ce qui lui a été reproché sur ses précédents films.
L’accroche au dos de la jaquette du DVD est d’ailleurs sans ambiguïté : « Miami. Cuba. Courses-Poursuites de folie, flingues qui claquent, B.O rap à tomber et rires qui explosent. »
Michael Bay devient pour de bon une marque de fabrique associée aux explosions et à l’effet feu d’artifice.

Après Bad Boys II, il ne retravaille plus avec Jerry Bruckheimer mais s’allie avec un nom bien plus prestigieux : celui de Steven Spielberg.
Leur première collaboration se fait en 2005 sur The Island, qui est unique en cela qu’il est le premier et le seul échec commercial de la carrière de Bay.
Le réalisateur cherche à profiter du nom de Spielberg pour risquer un film potentiellement plus ambitieux, mais il reste prisonnier de ses vieux démons.
En résulte un film au casting moins négligé et plus discipliné (Ewan McGregor et Scarlett Johansson), un récit plus posé durant la première moitié, même s’il pille par ailleurs sans vergogne les dernières décennies de cinéma SF plutôt que de créer quelque chose de nouveau, mais qui vire ensuite à la destruction massive habituelle dans sa deuxième partie.
Bay explose son record personnel de placements de produits : 35 au total. Avec Transformers 223, il en totalisera 47…
Ce premier échec ne freine pas sa collaboration avec Steven Spielberg, puisque c’est à ses côtés qu’il réalisera la saga qui le propulsera définitivement au premier plan sur le terrain du box-office : Transformers.
Une franchise qui semblait prédestinée au réalisateur, d’abord parce qu’elle constitue de fait un terrain de jeu qui lui sied : de grosses bagarres entre robots.
L’adepte de la destruction massive et de « bourrinades » pyrotechniques redevient un gosse sur des projets où l’action est omniprésente, et parfois dans des proportions que même Bad Boys II n’avait pas atteintes.
Lui qui aime tant les placements de produits se voit devenir le VRP de luxe d’Hasbro, en impulsant la tendance « WTF?! » de l’adaptation au cinéma de franchise de jouets.
La saga de Bay fait quelques adeptes à défaut de faire changer d’avis ses détracteurs, et le consacre pour de bon comme un poids lourd du box-office, avec près de 3,8 milliards de dollars récoltés en quatre films. À défaut d’obtenir la consécration critique, le réalisateur a fini par obtenir celle de l’industrie, dont la valeur est toute relative. Et à défaut de l’apprécier, on ne peut que constater la cohérence globale de sa filmographie.

Ayant réalisé son plus gros succès avec le troisième Transformers24, Bay s’offre une parenthèse « petit budget » éloignée de son registre habituel avec Pain and Gain25, avec Mark Wahlberg et Dwayne « The Rock » Johnson notamment. Cette farce sombre tirée d’un fait divers survenu au milieu des années 90, dépeint Miami au milieu du culturisme, des grosses voitures et de l’argent facile, dans un univers où la vulgarité est reine. Ce qui ne manque pas de rappeler les Bad Boys. Le film s’est pourtant trouvé ses défenseurs, plus nombreux qu’à l’ordinaire, trouvant que les effets de style habituels du réalisateur faisaient sens avec le récit et amenaient une portée critique sur l’univers qu’il dépeignait. On a même pu entendre que c’était du Coen’s brothers « sous-acide » ! D’autres, à commencer par l’auteur de ces lignes, y ont vu le geste odieux et cynique d’un réalisateur insultant ouvertement ses protagonistes et, d’une certaine manière, une partie des spectateurs qui ont participé à ses succès, le tout dans un déluge de vulgarité ostentatoire.
Cet intermède « intimiste » passé, il revient pour la quatrième fois à la franchise Transformers26 en renouvelant son casting et en tentant de rendre l’ensemble un peu plus « adulte » sans pour autant réussir à élargir son public. La franchise reste prisonnière de sa nature. La mue que certains ont vu dans Pain and Gain ne se vérifie pas tout à fait. Le film colle en effet au train des précédents, à quelques variantes près.
Le seul détail qui interpelle dans ce 4ème opus est une réplique prononcée en début de film, dans une salle de cinéma ayant fermé ses portes :
« C’est les films d’aujourd’hui le problème. Des suites, des remakes, que de la daube. »
Le comble du cynisme, venant d’un réalisateur devenu roi du box-office grâce à ses suites à rallonge, qui trouve en plus le moyen de cracher ouvertement dans la soupe ? Message subliminal marquant un ras-le-bol vis-à-vis d’un registre de films qui ne lui conviendrait plus ? Ou simple tentative d’autodérision ?
Le prochain film du réalisateur apportera peut-être des éléments de réponses… Un retour sur les écrans programmé pour janvier 2016 : 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi27 .
Le making of de Pearl Harbor :
1Pearl Harbor de Michael Bay – 2001
2Armageddon de Michael Bay – 1998
3Delivrance de John Boorman – 1972
4Le Point de Non-Retour de John Boorman – 1967
5Excalibur de John Boorman – 1981
6Braveheart de Mel Gibson – 1995
7Chasing Amy de Kevin Smith – 1997
8Mallrats de Kevin Smith – 1995
9Will Hunting de Gus Van Sant – 1997
10The Faculty de Robert Rodriguez – 1998
11Virgin Suicides de Sofia Coppola – 1999
12Titanic de James Cameron – 1997
13Flashdance d’Adrian Lyne – 1983
149 Semaines ½ d’Adrian Lyne – 1986
15Liaison Fatale d’Adrian Lyne – 1987
16L’Echelle de Jacob d’Adrian Lyne – 1990
17The Rock de Michael Bay – 1996
18Bad Boys de Michael Bay – 1995
19Transformers de Michael Bay – 2007
20La Chute du Faucon Noir (Black Hawk Dawn) de Ridley Scott – 2002
21Bad Boys II de Michael Bay – 2003
22The Island de Michael Bay – 2005
23Transformers : Revenge of The Fallen de Michael Bay- 2009
24Transformers : Dark Side of The Moon de Michael Bay- 2011
25Pain and Gain de Michael Bay – 2013
26Transformers : Age of Extinction de Michael Bay – 2014
2713 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi de Michael Bay – 2016